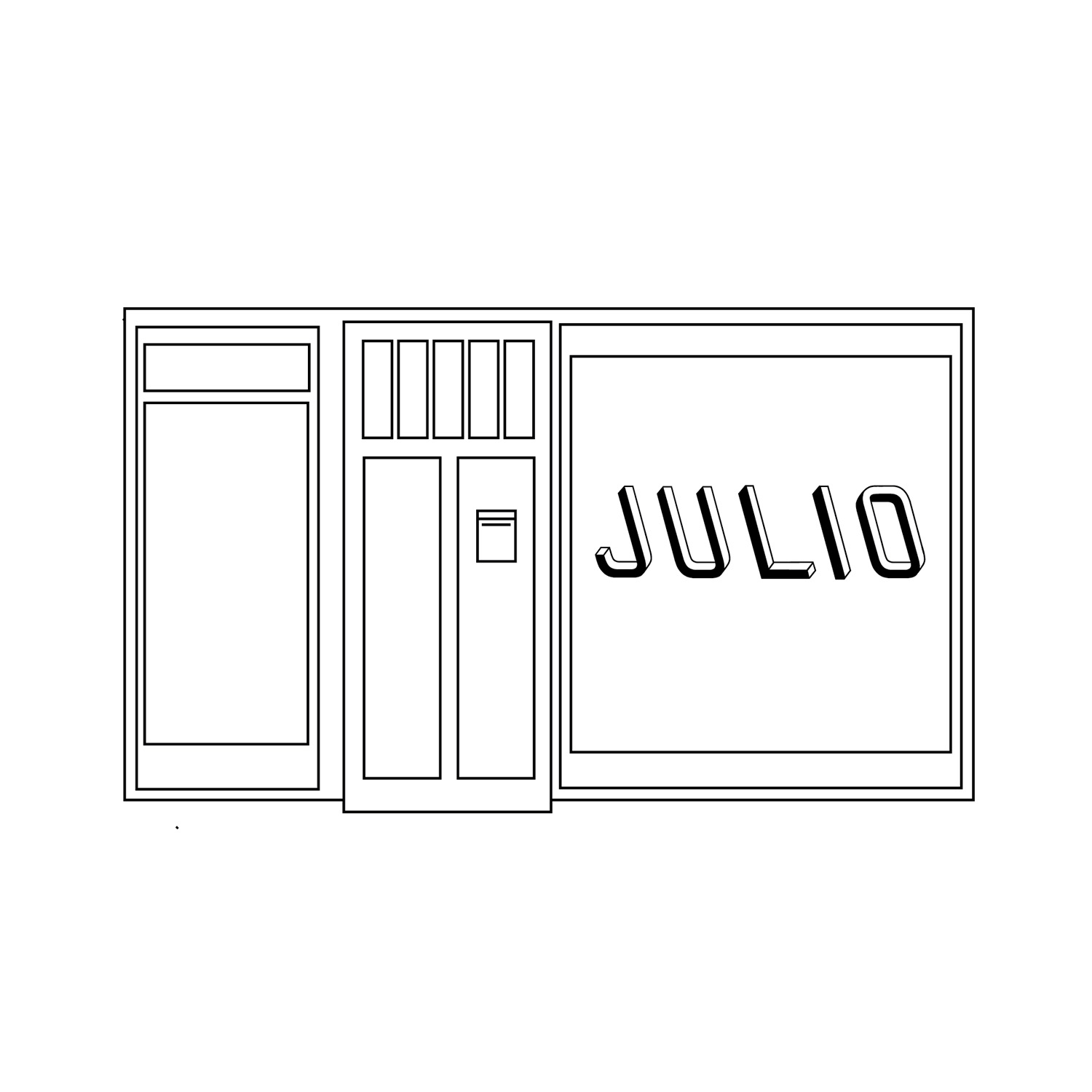On pourrait commencer par Il était une fois.
Une cité, faste et majestueuse. Faite de palais et de châteaux forts, ornés de mille colonnades et caryatides, resplendissante sous un ciel toujours clément. On pourrait faire le récit de sa grandeur puis de sa chute. Sauf que rien de tout ça. Il n’a pas été une fois. Dans l’exposition proposée par Julio, Sofia Fanego, Étienne François et Manon Pretto ne nous offrent pas une exposition-reconstitution, témoin d’un temps jadis. Nous ne sommes pas après, à constater rétrospectivement l’ampleur des dégâts. La merveilleuse cité n’exhibe pas ses vestiges.
Il est pourtant possible de s’y tromper, à en croire l’emprunt marqué à l’imagerie de l’Antiquité greco-romaine chez Étienne François, dont les tableaux mettent en scène ruines de temples, fragments de statues, vases ou amphores dans lesquelles des fleurs auraient repoussé. La végétation paraît avoir repris du terrain jusque dans les collages de Sofia Fanego, où les corps semblent y être statuaires, Vénus que des plantes invasives auraient recouvertes. Le temps semble avoir passé et a disloqué les choses. Ne restent du colosse que ses deux pieds, que Manon Pretto nous présente dans ses installations. Leur chute a fait voler le sol en éclat, comme une déflagration. On pourrait donc bien croire, dans cette exposition, que l’on arrive post effondrement.
Mais quelque chose nous résiste, on est peut-être allé.e.s un peu vite en besogne. En fouillant, en constatant les preuves de la catastrophe, on se rend compte que tout ce que l’on voit dissone avec cet enchaînement des faits. Les matières sont trop neuves, les images trop nettes, les couleurs trop synthétiques.
Si les photographies que Sophia Fanego utilise dans ses séries de collages sont effectivement d’un autre temps, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent une archéologie récente. Elles sont issues de magazines et livres d’occasion 60’s que l’artiste collectionne. On y voit de jeunes femmes nues, vision anachronique d’un corps féminin objetisé, hélas encore trop d’actualité. L’artiste en prélève des fragments, qu’elle assemble avec des plantes et fleurs séchées. Épousant les postures des corps, elles les dissimulent autant qu’elles s’y incorporent. L’artiste nous rappelle, par là, qu’un corps, si glossy et mystifié puisse-t-il devenir une fois mis en scène, est avant tout quelque chose de vivant, donc périssable. L’organique est une affaire de temps.
Même les pierres et les statues vieillissent, qu’elles représentent des divinités dites immortelles ou non. Les Talaria de Manon Pretto font sans conteste référence aux sandales ailées d’Hermès, messager de la mythologie grecque. Mais elles portent les extensions de 700, 350 V2, qui ne sont autres que des modèles de sneakers de marques de sport mondialement connues. L’indice le plus criant est sans doute la matière qui compose ces débris, aussi reconnaissable qu’actuelle. Sur des gravats in situ – issus de chantiers urbains alentours et prélevés peu avant l’exposition –, l’artiste présente des moulages de baskets en béton. Déformées par la pression du matériau, elles arborent des dégradés de couleurs fluo laissant presque croire à des modélisations 3D. L’érosion est fabriquée, anticipée. Et même si le marketing tente voracement de se saisir du temps, il lui glissera toujours entre les doigts.
Un dérèglement temporel est à l’œuvre, et notre perception du paysage chavire dans les peintures d’Étienne François. Si l’on y a vu, un bref instant, des scènes mythologiques, alors Hubert Robert a pris des acides. Les formes se diluent, architectures, nature et artefacts se mêlent dans une palette allant du vert amande au rose bonbon, résolument pop, trop vives pour qu’on les croie ternies par le temps. Et si Étienne François nous rassure en titrant une peinture Storm never lasts, le grand format Dare mighty things – qui reprend le message caché sous le parachute du rover Perseverance envoyé sur Mars par la NASA le mois dernier – nous rappelle que les grandes conquêtes de l’homme ne sont pas sans conséquences, et que rien n’est éternel.
Point alors l’idée que dans cette exposition, la catastrophe est plutôt celle d’un temps présent, dramatisée à la façon des grands mythes. On perçoit certes les échos de récits connus, ceux de chutes de grandes cités, punies pour leur orgueil face aux dieux, mais tout est un peu trop concret pour que l’on en reste aux légendes et aux récits bibliques. L’ambiance douce et colorée de l’exposition apparaît presque paradoxale lorsque l’on commence à se questionner sur ce que ces ruines 2021 ont à nous dire. À l’heure des désastres écologiques, sanitaires et politiques, à l’heure où l’eau monte, on entend l’Atlantide qui, comme à son bon souvenir, nous rappelle.
Carine Klonowski , Paris 2021