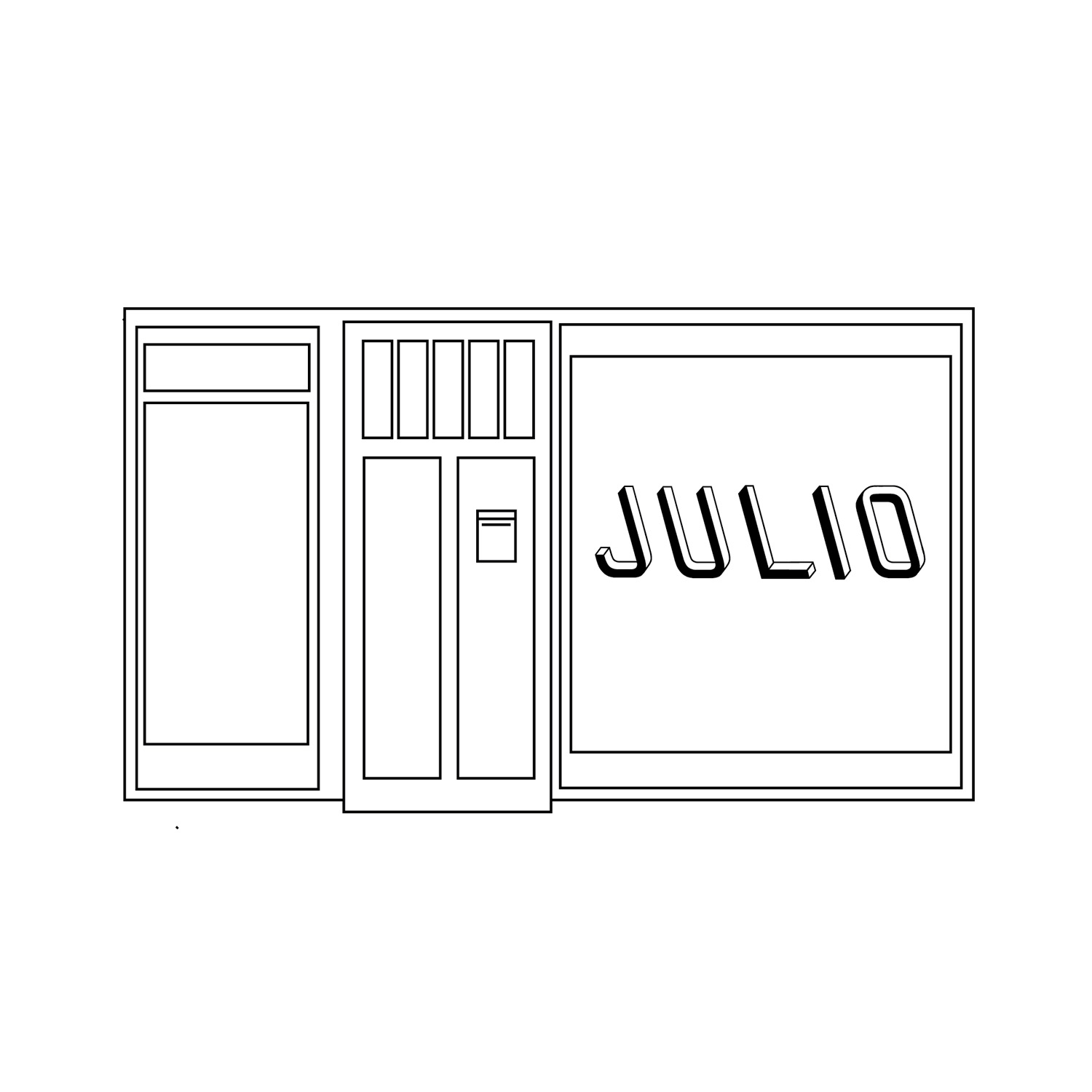SIP: Quelle place occupent les œuvres exposées à Julio dans l’ensemble de ton travail?
SK: En ce moment, je réfléchis à la manière de désengager mon travail du processus, de la technique et des matériaux. Depuis 2006 j’agit dans le cadre de l’art contemporain relationnel qui s’occupe des formes et outils des technologies sociales ; une tradition de longue date que l’on retrouve dans la célèbre citation de Max Dessoir: « Le fait de considérer une machine, la solution d’un problème mathématique, ou l’organisation d’un certain groupe social, en tant que choses belles, ce n’est pas seulement une façon de s’exprimer » (Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart 1906). Pendant un certain temps (ma préhistoire) j’ai séparé la sociologie et l’art jusqu’au moment où je les ai réunies dans ma pratique, d’abord avec L’origine du monde, (une étude des représentations de l’organe sexuel féminin chez les artistes masculins, 2005), puis avec l’installation vidéo La chasteté (2006-2007) et les banquets entre artistes et philosophes Technologies de l’amitié (2006-2007), ces deux en collaboration avec Roberto Jacoby.
Cette séparation entre la sociologie et l’art s’effectuait dans ta pratique ou dans ta conception de l’art?
J’ai cherché à les séparer délibérément dans ma pratique artistique jusqu’au moment où j’ai senti que ce n’était pas nécessaire, mais qu’au contraire, c’était dans le croisement de ces connaissances que j’allait produire des œuvres significatives. Depuis, j’ai travaillé sur la matière sociale, les relations sociales, la politique, la sexualité (Bath Revolution, 2009; Technologies de l’amitié et de la confrontación, 2010). Le travail présenté à Julio a comme origine un certain épuisement de ces manières de faire. Après 12 ans de ce type de parcours j’ai voulu produire un changement et j’ai pris une ligne de lecture stratégique, en tant que critique du paradigme de l’art social.
Je constate un éternel retour entre une critique de l’art social et l’art objectuel. On pourrait penser à une ontologie relationnelle et à une ontologie non relationnelle. Graham Harman propose l’idée d’une esthétique non relationnelle, une ontologie orientée vers l’objet, et pense que les objets du monde ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres ; une ontologie basée sur la corrélation des choses. Par exemple, on peut dire que si je déplace cette tasse les objets environnants sont affectés, ils sont en lien les uns aux autres.
En fait, la composition sur la table a été modifiée.
Mais pour Graham Harman en quelque sorte tout n’est pas lié, il y a eu besoin d’une action ou d’un effort pour cette mise en relation. Il n’y a pas de sujet ni d’objet, tout est objet. C’est un changement radical d’ontologie.
Au-delà de ces problèmes, je suis en train d’expérimenter un changement d’axe que je reconnais également dans d’autres discours et d’autres œuvres, une sorte de retour à l’objet, une rupture avec le relationnel, un retour à des formats plus traditionnels, une sorte de néo grimberisme. L’art moderne et avant-gardiste peut se penser comme un va et vient constant du modernisme aux avant-gardes; un certain retour à un modernisme esthétique, à l’objet, à l’œuvre, pour revenir à une nouvelle vague avant-gardiste et à la déconstruction de l’objet.
Pourquoi, au lieu de penser aux mouvements qui vont et viennent, ne pas penser aux artistes qui vont les chercher? Vu que la pratique artistique est une réécriture constante du présent.
Bien sûr, cela dépend du point de vue, ce sont des discours avec leurs propres forces qui reviennent comme des fantômes et se tiennent devant nous, les marionnettes du discours de l’art. Mais l’exprimer de cette façon est très structuraliste. Ils viennent, nous les cherchons, je ne sais pas. En analysant l’art argentin d’après-guerre, nous trouvons la peinture de Raquel Forner, ou le réalisme social d’Antonio Berni, puis une ligne qui s’ouvre vers l’art concret et une autre vers l’informalisme, qui se rejoignent plus loin. De l’informalisme on arrive à l’art destructif et à la dématérialisation de l’art. Et enfin, à l’activisme politique.
Il y a le pop’art.
Oui, qui conclut avec la dématérialisation totale de l’objet, une perte de l’objet lui-même jusqu’à atteindre une action politique directe. Je pense à certains artistes, comme Juan Pablo Renzi qui a participé à Tucumán Arde et qui redevient peintre dans les années 70 pendant la dictature. Un même artiste peut faire ce cheminement et traverser plusieurs de ces tournants. Personnellement, je retourne à un lieu qui m’appartient, bien que je ne considère pas cette période précédente de mon travail comme pertinente et quand je présente ma production je la fais démarrer en 2005. Avant cette date je travaillais autour de l’objet, puis j’ai évolué autour du non-objet, et maintenant je fais un retour à la chose objectuelle mais non à l’objet traditionnel. La pièce que je présente à Julio est un tableau qui contient un texte qui réfère à des chansons, ce n’est pas une simple «relation-objet», «choses-rapports humains», il y a une tension entre la peinture, le poème, le thème musical.
Mais il y a plus qu’une tension. Commençons par le début: comment as-tu composé les chansons? Les poèmes les ont précédé? Quelqu’un t’avait proposé de faire un album?
Ma relation avec la musique est de longue date. La musique a toujours été pour moi une affaire de l’ordre du collectif, c’est compliqué de faire de la musique, de rassembler six personnes, de jouer … Donc je l’ai quitté pendant plusieurs années, sauf ponctuellement. Je jouais dans un groupe appelé Laverap et j’ai fait de l’improvisation. Dernièrement, je me suis mis à voyager avec une guitare acoustique et à composer des chansons sur des textes que j’écris. J’ai envoyé quelques chansons à un ami musicien appelé DDM qui vit à Rio de Janeiro, son groupe s’appelle Santos Dumont. C’étaient deux chansons enregistrées avec l’i-phone. Ils les ont aimé et il les a produites en ajoutant d’autres instruments. À cette époque j’étais à New York et nous avons commencé un dialogue autour de cinq chansons. Les six autres je les ai enregistré et arrangé aux différents endroits du monde où me menait mon activité. Nous avons pu terminer l’album pendant un voyage au Brésil en profitant que le batteur du groupe était en ce moment à Rio de Janeiro. A Buenos Aires nous ont rejoints les musiciens de mon ancienne bande, nous avions joué ensemble depuis l’âge de treize ans.
Je voulais juste faire un album à ma guise, j’ai utilisé ma boîte à outils et tout ce que je savais déjà faire. Avec ce groupe, dans mon adolescence, on jouait dans différentes villes, j’ai récupéré un savoir faire qui était en moi mais que je n’avais pas utilisé depuis cette époque là.
Que disent les textes? Ont-ils une corrélation?
Comme dans un album, il y a une certaine unité thématique avec quelques débordements. L’axe central, le langage des pierres, surgit de mes lectures de cette époque: une discussion sur l’humanisme, le réalisme spéculatif, Quentin Meillassoux, Graham Harman, Ray Brassier, la critique du kantisme et de Nick Land, entre autres. Quentin Meillassoux critique la philosophie post-kantienne, la connaissance des objets du monde à partir du sujet. L’objet lui-même est incompréhensible en dehors d’une relation avec le sujet. Mais comment pouvons-nous connaître les événements qui précèdent la langue et la vie humaines, y compris l’origine de la terre et de l’univers, sans un observateur humain qui puisse faire le lien entre l’existence de cet objet et sa manifestation ?
Ce à quoi tu faisais référence au début de cette conversation…
C’est cela la philosophie, une épistémologie, qui donne fondement à nos capacités de connaître, aux facultés de la compréhension établies surtout par Kant. Selon Quentin Meillassoux depuis la physique de Newton nous étudions des choses qui lors de leur apparition sont dépourvues d’un observateur. La science peut essayer de décrire l’origine de l’univers, dont l’événement s’est produit indépendamment de notre observation, et on peux créer un discours sur ses évènements, un matérialisme spéculatif. La physique étudie des événements précédant l’homme, la langue, la vie humaine, qui se sont produits sans que personne n’y soit présent.
Ces idées m’ont frappé et j’ai voulu jouer avec. Je l’ai fait de différentes manières : j’ai édité un dossier pour la publication de CIA, l’organisme de formation et investigation dans lequel je travaille, pour lequel j’ai traduit des textes et invité Gabriel Catren (physicien et philosophe) à donner une conférence ; j’ai réalisé un entretien avec Graham Harman, écrit un commentaire du livre de Quentin Meillasoux, et traduit un fragment dans lequel il réfléchit à propos du texte de Mallarmé «Un coup de dés jamais n’abolira le hasard». J’ai aussi composé des chansons et peint des tableaux.
Pour ce travail sur l’objet tu as choisi des phrases de tes chansons, pour les superposer sur des images préexistantes et peindre l’ensemble. On trouve des paysages, des architectures abandonnées, parfois des objets, il n’y a pas de personnages. Quels sont les critères du choix des phrases et quelles relations entretiennent avec la sélection des images?
En général je travaille de manière projective, mais parfois, je m’ennuie et je fais autrement. Dans le faire je peux m’écarter de la méthode préétablie. De ce processus se sont dégagés trois séries. Une d’elles est Useless landscapes. J’ai eu une proposition d’exposition dans le New Jersey et j’ai voulu travailler avec le paysage, qui est un genre très important pour les Américains.
Bien sur, il était nécessaire de décrire ce nouveau territoire en utilisant d’abord les manières de représentation européenne comme validation des images d’un paysage sans histoire.
Je me suis intéressé à cette lignée de l’histoire de l’art des USA, la peinture des paysages imposants, comme le Canyon du Colorado. Et au golfe du Mexique, au cratère créé par l’impact de l’astéroïde qui a changé les modes de vie sur terre, où un mode de vie a pris fin et un autre est apparu. La galerie qui m’a fait cette proposition est loin de la ville, ses propriétaires sont des «farmers». Pour moi, qui viens d’un conceptualisme politique, c’était un changement et une expérience qui m’intéressait. J’ai voulu me laisser traverser par cet endroit qui est pur paysage. Les textes corrompent le paysage qui devient inutile.
Mais quelle serait la première utilité du paysage devenue inutile? La fonction descriptive?
Le paysage est comme faire des cartes.
Donc, l’utilité topographique?
Oui, par exemple la représentation des batailles. Le fait de leur associer le texte rend inutile la fonction du paysage et le transforme en réflexion conceptuelle, en une discussion philosophique d’un autre ordre.
Avec la contiguïté du disque, cette discussion ne s’arrête pas à l’objet peinture.
Cette phrase : « je parle la langue des pierres quand je marche dans le village de tes synapses», dit assez. Les paysages ne sont pas exclusivement des images des États-Unis, il y a des paysages sidéraux, un big bang, les pyramides d’Egypte ou les montagnes d’Islande. Les paysages des lieux où j’ai voyagé, j’aime cette idée du voyageur.
Et du découvreur ? Le premier à voir ce paysage doit laisser une image, et il y a tout un aspect de l’histoire de la peinture liée à cela.
Oui, mais sur terre presque tout est déjà cartographié. Si j’étais un astronaute, j’irais voir Mars. Un autre groupe de peintures utilise des images de lieux dévastés, propose un art post-capitaliste, une fausse utopie. Ce sont des centres commerciaux totalement détruits, et les marchandises du future.
Ces peintures sont des commentaires ironiques.
Oui, la phrase » Collectors buy the aura » sur un tableau impressionniste semblable à un tableau de Claude Monet, c’est une blague, car bien que la dématérialisation de l’art ne soit rien de nouveau, il y a une grande résistance des collectionneurs à acheter ce type d’œuvre même après 60 ans de leur existence. C’est une série de peintures théoriques, ce sont des hypothèses, des thèses, des concepts peints, autour des problèmes actuels, des lectures, suivant l’idée que la peinture et la théorie ne sont pas opposées. Ce n’est peut-être pas le cas pour un historien des idées, mais je voulais travailler en tant que théoricien et peintre à la fois. Par exemple, en pensent à l’objet, sur une surface monochrome, j’ai ajouté une phrase qui dit » Art makes you perform « , l’œuvre vous fait agir, l’objet inclut l’action, pas seulement les gens agissent, l’art a une capacité d’agent. Dans une autre peinture, le mot » Singularity » se superpose à une image d’un pot de colle et des ciseaux, parlant du collage comme métaphore. Le copier-coller a été expérimenté par l’avant-garde, par le cinéma, en tant que média d’expérimentation, et dans la littérature par l’écriture non créative qui utilise le couper-coller pour produire du texte. L’acte de copier fait des originaux. Dans une autre peinture j’ai écrit « Shanzhai ». Le concept chinois de shanzhai est une pratique de appropriation et copie, la copie n’est pas comme en occident considéré comme une falsification.
C’est recréer l’objet à chaque fois.
Un bon artiste était celui qui copiait très bien. Dans le bouddhisme il n’y a pas d’origine des choses, la transformation est perpétuelle sans distinguer une origine et une fin. C’est une mutation.
Avec ce concept j’ai réalisé deux tableaux. Le mot « shanzhai » est écrit sur l’image des guerriers en terre cuite, que j’ai vus lors d’un voyage en Chine et qui m’ont beaucoup impressionné. Sur une autre peinture j’ai écrit le même mot mais en utilisant des caractères chinois sur une image de mon appartement à Hong Kong. Les peintures expriment parfois des faits tangentiels et parfois elles sont très littérales.
«I swim In The Tidal Wave», cette phrase sur l’image d’une vague propose une interprétation littérale, même redondante.
C’est la redondance qui crée l’ironie.
Quels sont tes prochains projets?
J’ai fait des diptyques d’aquarelles et des textes sur la culture «white trash» américaine à partir de phrases de Stephen Bannon. C’est un travail en collaboration avec Claudio Iglesias et sera bientôt exposé.
Comment est née cette idée en collaboration?
-Nous avons beaucoup parlé de Trump et des élections, d’où la création du magazine Jennifer que nous avons lancé en novembre 2016. Les aquarelles adoptent le concept d’image de Jennifer. Pour cette revue nous avons crée des alter ego, un critique d’art et un artiste qui écrit. Claudio Iglesias était fasciné par la façon dont Stephen Bannon a réussi à faire gagner Trump en choisissant des sujets abominables aux yeux de la classe moyenne « bien cultivée », de gauche progressiste. Ce travail sera montré dans une galerie à Soho où je vais présenter aussi une version de l’œuvre Diarios del odio avec des textes composés à partir des commentaires racistes et xénophobes du journal américain Breitbart News. Je vais utiliser le dispositif de la peinture murale que j’ai déjà expérimenté. Je veux aussi l’éditer en format livre. Pour cela je cherche à travailler avec une équipe de recherche dans le cadre d’une université. Je termine également trois livres, une anthologie de la revue Ramona avec une introduction sur l’histoire de la revue, un livre sur la l’histoire de l’art argentin de la crise de 2001 aux années Kirchner, et un roman sur «male strippers», ainsi que des aquarelles, peintures et autres pièces participant de l’esthétique de cette culture, avec ses matériaux propres comme par exemple des élastiques.
Voici les photos de l’exposition Assemblage #10: http://spaceinprogress.com/works/assemblage-10-engager-le-corps/